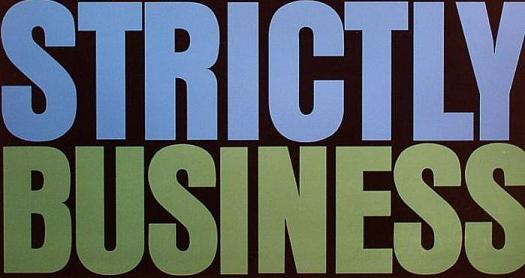The Shield s’achève. On se tient là, tout seul, au bord d’un
champ de ruines qui s’étend à perte de vue. On aperçoit des destins
tordus surgissant de terre comme des croix, des vies brisées en deux,
fichées dans le sol, des passés réduits à des monticules de cendres et
un avenir dans lequel errent les survivants. C’est la fin de sept
saisons qui ont retracé le récit d’une guerre, celle qu’un homme a
menée contre une ville, contre ses supérieurs, contre ses ennemis et
contre ses amis, contre la Terre entière finalement, à l’exception de
sa famille.
La série, créée par Shawn Ryan, fait partie des plus grandes jamais
diffusées, en raison de sa cohérence, de la maîtrise d’une histoire
souvent compliquée, de la qualité constante des saisons et du jeu de
ses acteurs, presque tous irréprochables. On pourrait reprendre les
premiers épisodes (datant de février 2002) et les regarder à nouveau
avec un plaisir quasiment intact. Car entre l’assassinat de Terry
Crowley, qui marque le point de départ de l’histoire, et l’ultime
scène, qui constitue un contre-pied (PAS DE SPOILERS DANS LES COMMENTAIRES SVP),
il existe une effrayante logique. On a pu comparer The Shield avec la
tétralogie écrite par James Ellroy, mettant en scène son quatuor de Los
Angeles dans les années 40 et 50. Les deux projets s’imposent comme des
sagas, relatant sur une période de temps relativement longue les
aventures d’un groupe d’hommes confrontés à la question de la violence,
des hommes obligés de s’impliquer dans l’éternel combat du Bien et du
Mal.
La comparaison avec les Quatre de L.A. n’est pas totalement juste. Dans Le Dahlia Noir, Le Grand Nulle Part ou encore L.A. Confidential,
Ellroy tentait de peindre le portrait d’une époque révolue de la Cité
des Anges, une époque de son enfance, dont il a gardé sinon la
nostalgie, du moins des souvenirs profondément ancrés en lui. The
Shield dresse partiellement le tableau d’une ville, ou plus précisément
de l’un de ses quartiers (fictif), Farmington. Cela dit, le
rapprochement de ces deux oeuvres majeures est pertinent sur un point.
La mise en mouvement du destin est inarrêtable. Les hommes se
découvrent prisonniers des événements qu’ils ont déclenchés. Pour Vic
Mackey (Michael Chiklis), comme pour Dudley Smith, la vie n’est plus
qu’une longue et lente fuite en avant, et la survie devient, comme dans
une tragédie classique, l’ultime et unique enjeu.
“You are a sick twisted man”, affirme l’agent fédéral, Olivia
Murray, s’adressant à Mackey. D’un point de vue moral, elle a raison.
Sa place n’est pas à la tête de la Strike Team, mais dans une cage avec
le chef de gang Antwon Mitchell. Ces deux-là, s’ils s’affrontent sans
pitié, partagent tant de valeurs communes qu’ils devraient se trouver
du même côté de la barrière. Malgré tout, les choses ne sont pas aussi
simples. Jusqu’au bout, Mackey reste un élément précieux pour la police
dans la lutte contre la délinquance. Il obtient des résultats et l’idée
qui est suggérée est que pour combattre efficacement les monstres, il
faut parfois être comme eux, vivre selon les mêmes règles, partager les
mêmes lois, se nourrir de la même violence. Ryan aurait pu s’en tenir à
ce constat, comme le fait Ellroy. La grande subtilité de The Shield est
que cela va plus loin.
Il est possible de combattre le crime, de tenter de servir l’ordre,
en employant les armes de ses adversaires, mais il est également
possible de mener cette bataille en tentant de sauver son âme. C’est la
raison d’exister de Claudette Wyms (CCH Pounder) et de “Dutch”
Wagenbach (Jay Karnes). Avec mention spéciale pour ces deux acteurs. La
beauté de The Shield est d’avoir su mettre en regard ces deux
conceptions du métier de flic, en leur accordant une part équivalente,
en ne privilégiant pas l’une par rapport à l’autre. Le credo de Mackey
et de la Strike Team est celui de l’efficacité rapide, toutes les fins
justifiant tous les moyens. La philosophie de Wyms et de Wagenbach est
d’admettre que les moyens sont le plus souvent limités par la morale,
mais que cette limite n’exclut pas d’atteindre une fin.
En imposant des règles du jeu qu’il a lui-même définies, Mackey
oblige ceux qui l’entourent à se poser des questions sur eux-mêmes. Il
les contraint à prendre position, pour ou contre lui. Sa simple
présence interdit la neutralité, telle que la revendique sa femme
Corrine (Cathy Cahlin Ryan) -qui n’a qu’une envie, être débarrassée de
son mari- ou l’agent Danni Sofer (Catherine Dent) qui regrette très
vite d’avoir laissé cet homme entrer dans son existence. Sans que cela
soit dit clairement, on a le sentiment que Mackey est porteur d’une
malédiction. Son fils souffre d’autisme. Il abime tout ce qu’il crée,
tout ce qu’il touche, la corruption de son caractère est contagieuse et
il n’existe pas d’antidote. Cela est particulièrement évident pour ses
proches, Shane Vendrell (Walton Goggins), Ronnie Gardocki (David Rees
Snell) et Curtis Lemansky (Kenny Johnson), mais également pour ceux qui
s’opposent à lui.
Wagenbach est, un moment, pris de doutes. Il flirte avec
l’illégalité et enfreint les règles pour surmonter la frustration de
l’échec. Wyms envisage, elle aussi, un instant de ne plus jouer le jeu,
de faire tomber Mackey à tout prix. Avant de se ressaisir. L’ancien
capitaine David Aceveda, à l’origine de l’enquête contre Mackey,
comprend qu’il est obligé de coucher avec le diable, de se laisser
embarquer dans son lit, s’il veut un jour devenir maire de la ville.
Enfin, l’officier des Affaires internes John Kavanagh (incarné
magnifiquement par Forest Whitaker) n’échappe pas à la contagion. Ne
parvenant pas à réunir les éléments nécessaires pour inculper son
rival, il se laissera guider par la haine, la folie et le besoin
d’assouvir sa vengeance: il fabriquera des preuves et réduira à néant
tous ses efforts, se détruisant lui-même.
La force de Vic Mackey est celle d’un survivant. Au fil des affaires
dans lesquelles il est impliqué, on s’aperçoit que plus la situation
est compliquée, plus il marche sur le fil du rasoir, et moins il a le
vertige. Plus, il est à l’aise. Son talent, c’est de négocier, de
trouver un double-fond dans le double-fond du double-fond du tiroir, et
de créer le doute et la confusion parmi tous ceux qui l’entourent.
C’est à l’instant où l’on croit que la situation va lui glisser entre
les mains, qu’il s’y arrime encore plus solidement et tire sur la corde
pour faire pencher le plateau de la balance de son côté. Aucun autre ne
possède ce talent et aucun autre ne peut donc rivaliser avec lui.
Mackey est également habité par la conviction qu’il est plus malin que
les autres, plus malin que tous les autres, qu’il pourra toujours -même
au prix de renoncements profonds- se jouer d’eux et finir par s’en
sortir. A sa manière, il les méprise et les écrase de son regard bleu
clair. On en vient alors à se poser cette question: n’y a-t-il pas en
lui quelque chose d’indestructible ? La réponse est, sans doute. Ce qui
est suggéré (là non plus, sans être dit), c’est qu’il existe quelque
part des hommes comme lui, et qu’il en existera toujours, qu’ils seront
encore là demain pour répandre le malheur autour d’eux, tout en
affirmant vouloir faire le bien et en étant convaincus qu’au fond,
c’est ce qu’ils font.
Au fil des sept saisons, Mackey ne change pas. Il n’évolue pas
vraiment, contrairement aux autres. Il est le seul à demeurer le même
et c’est ce qui constitue sa force. Il sait faire des choix, aussi
douloureux soient-ils quand les circonstances le lui imposent. Chaque
saison peut se regarder indépendamment, mais pour ceux qui n’auraient
pas encore poussé la porte du commissariat de Farmington, le mieux est
de commencer… par le commencement. Et puis, de se laisser porter par
l’histoire. La manière de filmer est tout à fait étonnante et a fait
école. Dans certaines scènes, la multiplication des plans est telle,
que l’on en a le vertige.
La saison 5 reste certainement comme un moment à part, traversée par
une furie longtemps contenue avant d’exploser dans une tirade de
Kavanagh à la fois magnifique et désolante parce que sonnant comme un
aveu d’impuissance absolu. Elle est à mettre en regard, du point de vue
de l’intensité, avec la fin de la saison 7 et notamment avec les deux
derniers épisodes qui sont juste sublimes. On en reste pantois, la
bouche sèche, et légèrement sonné comme après avoir reçu un coup sur la
tête.
On pourrait écrire encore bien des choses sur The Shield tant est
grande la richesse de cette série. Mais, certainement, le mieux est de
la regarder, de se laisser submerger et ensuite de la ranger
religieusement à côté de The Wire ou des Sopranos, en
attendant un jour lointain, où on la descendra de l’étagère pour
contempler à nouveau un champ de ruines qui s’étend à perte de vue.
Excellent chronique du blog du Monde.